À Saint-Leu-la-Forêt, l’histoire napoléonienne tisse des liens avec les Pays-Bas
Peu savent que durant le règne de l’empereur Napoléon III, de 1852 à 1870, Saint-Leu-la-Forêt s’est appelée Napoléon-Saint-Leu-Taverny. Quels liens la petite ville située au nord de Paris entretient-elle avec la famille Bonaparte? Et en quoi son histoire est-elle indissociable de celle des Pays-Bas? De Louis Bonaparte, roi de Hollande et comte de Saint-Leu, jusqu’à son fils Napoléon III, une Néerlandaise installée dans le Val-d’Oise remonte le fil d’une histoire qui relie sa région d’adoption à son pays d’origine.
Louis Bonaparte, roi de Hollande de 1806 à 1810, aspirait à devenir un monarque national, protecteur du peuple néerlandais, tandis que son frère, l’empereur Napoléon Ier, attendait de lui qu’il agisse avant tout dans l’intérêt de la France. Les conflits entre les frères ont conduit à l’abdication de Louis, suivie par l’annexion des Pays-Bas à l’Empire français. Malgré sa courte durée, le règne de Louis a laissé des traces indéniables dans la société néerlandaise. Mais c’est à Saint-Leu-la-Forêt, en région parisienne, que repose sa dépouille, dans une église aménagée par son fils Napoléon III. Il est émouvant de découvrir la tombe et la statue de Louis, roi de Hollande et comte de Saint-Leu, dans cette petite ville de la banlieue parisienne au moment où les Pays-Bas réévaluent positivement son héritage.
 Une statue de Louis, roi de Hollande et comte de Saint-Leu, trône dans l'église aménagée par son fils Napoléon III.
Une statue de Louis, roi de Hollande et comte de Saint-Leu, trône dans l'église aménagée par son fils Napoléon III.© Dorien Kouyzer
Comte de Saint-Leu
J’habite le Val-d’Oise depuis 1990, mais ce n’est qu’en 2012 que j’ai remarqué le caractère «napoléoniste» de Saint-Leu-la-Forêt, l’année où la petite ville, située dans la pittoresque vallée de Montmorency, a rejoint le réseau des villes impériales. À cette occasion, certaines vitrines du centre se sont ornées de symboles napoléoniens et exposaient des livres et brochures sur les règnes de Napoléon Ier et de son neveu Napoléon III, personnages qui auraient visité la ville. À l’époque, j’ai haussé les épaules et j’ai continué mon chemin.

C’est seulement l’hiver dernier, quand des amis m’ont raconté avoir vu les tombeaux d’un frère de Napoléon Bonaparte et de deux de ses neveux lors d’une visite de la crypte de l’église Saint-Leu-Saint-Gilles, que ma curiosité de Néerlandaise a été réveillée. Il s’est rapidement avéré qu’il s’agissait bien de Louis Napoléon qui a été roi de Hollande. De celui-là même qui, à la surprise de mes amis, et ce, malgré son statut d’occupant français, n’a pas trop mauvaise réputation dans mon pays d’origine. En effet, sa contribution à la formation de l’État-nation et à la fondation de la monarchie moderne est de nos jours considérée comme d’une importance majeure pour les Pays-Bas.
Désormais, la relation entre Saint Leu et les Bonaparte m’intrigue et, guidée par les publications de l’association Saint-Leu Terre d’Empire qui me fera visiter l’église et la crypte par la suite, je reconstitue son histoire. Tout commence par l’acquisition en 1804 du château de Saint-Leu par Louis Bonaparte et son épouse Hortense de Beauharnais, fille de la première femme de Napoléon Bonaparte, Joséphine. L’achat de ce château construit en 1693 et son domaine a pu se faire grâce à un cadeau de mariage un peu spécial. Napoléon Ier et Joséphine –qui ne réussissaient pas à avoir d’enfants ensemble– ont forcé Hortense et Louis –qui ne s’entendaient absolument pas– à se marier afin de procurer à l’Empire un héritier du même sang que celui du couple impérial. Pour se faire pardonner cette union arrangée uniquement dans son propre intérêt, l’Empereur offre au jeune couple une belle somme pour l’achat d’une propriété. Les époux optent pour le village de Saint-Leu et obtiennent le titre de comte et comtesse de Saint-Leu.
 Louis Bonaparte et son épouse, Hortense de Beauharnais, comte et comtesse de Saint-Leu
Louis Bonaparte et son épouse, Hortense de Beauharnais, comte et comtesse de Saint-Leu© domaine public
Du mariage malheureux de Louis et Hortense naissent tout de même trois garçons: Napoléon-Charles, Napoléon-Louis et Charles-Louis-Napoléon. Après la séparation du couple en 1810, Hortense vit seule dans le château avec ses enfants, mais, en tant que fidèle de l’Empereur, elle doit quitter la France après la chute de l’Empire en 1815. Elle meurt en exil en 1837. Louis mourra en Italie en 1846. Attaché à Saint-Leu, il avait exprimé le souhait d’être enterré dans son église. Son corps y est enseveli solennellement en 1847, aux côtés de ses deux premiers fils et de son père, Charles Bonaparte. Deux ans plus tard, son troisième fils, alors président de la Deuxième République, mais bientôt empereur sous le nom de Napoléon III, vient se recueillir sur le tombeau de son père et de ses frères. Découvrant l’état de délabrement de l’église, il commande les plans d’un nouvel édifice à l’architecte Eugène Lacroix. Par ce geste, Napoléon III a voulu également rendre hommage à la ville dans laquelle il avait passé ses années d’enfance (1808-1815).
 Le château de Saint-Leu vers 1807
Le château de Saint-Leu vers 1807© domaine public / Wikimedia Commons
La nouvelle église de St-Leu-St Gilles, typique du XIXe siècle, faite de matériaux simples, est, telle que je la découvre, décorée avec goût. L’intérieur de la nef abrite plusieurs monuments remarquables, comme la statue de marbre représentant Louis, roi de Hollande, en costume de sacre. En 1862, Napoléon III inaugure cette statue imposante et fait don des magnifiques orgues Cavaillé-Coll. Les motifs impériaux –l’aigle, les abeilles, les monogrammes N (pour Napoléon)– sont présents un peu partout. On remarque, à côté de l’aigle impérial, le lion du blason néerlandais sur le socle de la statue et une plaque commémorative du Skål Club Nederland (le Skål est un réseau international de responsables du tourisme) datant de 1995. Pour le reste, rien ne témoigne des relations avec les Pays-Bas.
 Détails de l'église et de la crypte: le sarcophage de Charles-Marie Bonaparte derrière lequel se profile l'aigle, un monogramme N, pour Napoléon, et le flanc du sarcophage de Louis Bonaparte.
Détails de l'église et de la crypte: le sarcophage de Charles-Marie Bonaparte derrière lequel se profile l'aigle, un monogramme N, pour Napoléon, et le flanc du sarcophage de Louis Bonaparte.© Dorien Kouyzer
La crypte située sous le chœur de l’église est divisée en deux salles par des arcades portées sur des colonnes hexagonales. Les chapiteaux sont ornés de feuillages et de monogrammes. La voute se présente sous un assemblage d’arêtes plates très XVIIIe siècle. Un aigle en bronze dont l’aile est trouée par une balle attire l’attention. S’y trouvent quatre sarcophages de pierre, dont l’un est vide. Il s’agit de celui de Charles-Marie Bonaparte, père de Napoléon Ier et de Louis; son corps a été remis à la Corse en 1951. Les trois autres sarcophages abritent les corps de Louis Bonaparte (1778-1846) et de ses fils Napoléon-Charles (1802-1807), mort à La Haye à l’âge de 4 ans, et Napoléon-Louis (1804-1831), mort en Italie.
Le début de la période dite «française» aux Pays-Bas
À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, bien des choses distinguent la France des Pays-Bas. Tandis que durant ses années révolutionnaires et impériales, la France continue d’être une grande puissance dominant le continent européen, la République des Provinces-Unies (1579-1895) a déjà en grande partie perdu son pouvoir économique et politique durant le XVIIIe siècle. En outre, la France a une longue tradition monarchique de centralisation étatique tandis que la République des Provinces-Unies se caractérise par le particularisme.
Toutefois, des parallèles d’ordre sociopolitique existent bel et bien entre les deux pays. Ainsi, à partir des années 1780, un peu avant la France, la République des Provinces-Unies avait également connu une période révolutionnaire ayant mené à une guerre civile. Aux citoyens réformistes qui se qualifiaient de patriotes se sont opposés les conservateurs orangistes, fidèles au prince d’Orange. Les patriotes souhaitaient mettre fin à la corruption et prônaient un partage équitable des charges, la liberté de religion, une presse non censurée et un gouvernement démocratiquement élu. Même si cette révolution dites batave a été moins violente et moins radicale que la française, elle a profondément marqué l’esprit des contemporains.
 La nouvelle église de St-Leu-St Gilles, typique du XIXe siècle, où repose entre autres Louis Bonaparte.
La nouvelle église de St-Leu-St Gilles, typique du XIXe siècle, où repose entre autres Louis Bonaparte. © Dorien Kouyzer
Le clivage s’est accentué encore quand les patriotes ont acclamé les Français lors de leur invasion de 1794-1795. Un important contingent néerlandais faisait même partie intégrante de l’armée révolutionnaire française! Cette invasion a mené à la faillite de la République des Provinces-Unies et à la fondation de la République batave (1795-1806). Les Français accueillis comme des libérateurs se sont plutôt conduits comme des occupants. À savoir que la France a tout simplement annexé la Flandre zélandaise et le Limbourg, tout comme les Pays-Bas autrichiens. Et que le territoire restant, baptisé République batave, ne devait pas seulement payer des sommes colossales à la France, mais aussi entretenir l’armée d’occupation française. Rapidement, l’état-sœur s’est révélée être un État-satellite.
Le 5 juin 1806, l’empereur français Napoléon Ier nomme son frère Louis, âgé de 27 ans, roi de Hollande. Afin d’éviter une annexion complète à la France, les Néerlandais acceptent ce roi. Ainsi la jeune République batave croulant sous les dettes et les impôts se transforme en un royaume vassal de l’Empire français.
Le bon roi Louis
Appartenant à la jeune dynastie des Bonaparte, Louis est censé faire passer les intérêts de l’empire avant ceux de son royaume, tout comme les autres membres de sa famille installés sur les trônes européens. Cependant, le profil de Louis n’y semble pas tout à fait adapté. En humaniste imprégné par les Lumières et adepte de Rousseau, le jeune homme, qui se fait appeler Lodewijk Napoleon, se voit bien en «majesté nationale»- une qualification censée exprimer qu’il prend à cœur les intérêts de ses sujets.
 Jan Anthonie Langendijk Dzn, L'Arrivée de Louis Napoléon à Amsterdam le 20 avril 1808
Jan Anthonie Langendijk Dzn, L'Arrivée de Louis Napoléon à Amsterdam le 20 avril 1808© domaine public / collection Rijksmuseum
Lors de son règne, ses préférences et l’expérience acquise en tant que militaire et membre du Conseil d’État français semblent jouer un rôle dans les domaines de l’administration, de l’assistance sociale, de la défense, de la législation et de la culture. Son mandat lui permettant d’entreprendre des grands changements à tous les niveaux de la société, il se met énergiquement au travail. Conformément aux règles impériales, Louis s’assure du soutien de la classe supérieure locale en nommant des natifs comme collaborateurs. Il choisit ses ministres, conseillers, administrateurs et généraux néerlandais en fonction de leur talent, de leur obéissance et de leur position sociale et non de leurs convictions politiques (1). Cette stratégie de réconciliation lui permet d’acquérir la confiance –condition sine qua non pour pouvoir transformer la société– des nombreux citoyens souhaitant mettre fin à la division entre orangistes et patriotes qui ronge la société depuis déjà longtemps. L’abondante correspondance entre Napoléon et Louis (2) témoigne de l’énervement de l’Empereur face à ce jeune frère un peu idéaliste qui ne donnerait pas suffisamment préséance aux intérêts de l’Empire.
En monarque moderne et héritier de la Révolution française, Louis se soucie de mettre fin à la fédération peu transparente qui regroupe alors les provinces, villes et nombreux petits comtés et duchés ayant tous leurs propres lois. Il aspire à un État-nation unifié. Dans cette logique, il consolide le système éducatif national accessible à tous, lancé par la République batave, et impose le néerlandais standard en tant que langue nationale, deux outils majeurs pour créer un sentiment national nécessaire à la centralisation. Louis ne s’arrête pas là: afin d’assurer une plus grande transparence politique et plus d’égalité, il restructure le gouvernement et la justice en adaptant le modèle français à la situation locale. Il pourvoit les mondes de la science et de l’art d’institutions nationales –existant encore aujourd’hui– et il est actif dans les domaines du social et de la santé. Il intervient notamment en personne pour faire baisser la mortalité des nourrissons, réguler le niveau des eaux, rénover les quartiers insalubres, améliorer la condition des prisonniers et restituer aux catholiques, là où ceux-ci sont majoritaires, les églises occupées par les calvinistes.
 Louis Bonaparte fait de longues tournées dans les régions et il se dépêche sur les lieux lors d’inondations et d’incendies, comme représenté sur le dessin de Jan Willem Pienema, Louis Napoléon visite les ruines du Rapenburg à Leyde après l'explosion du bateau de munitions le 12 janvier 1807.
Louis Bonaparte fait de longues tournées dans les régions et il se dépêche sur les lieux lors d’inondations et d’incendies, comme représenté sur le dessin de Jan Willem Pienema, Louis Napoléon visite les ruines du Rapenburg à Leyde après l'explosion du bateau de munitions le 12 janvier 1807. © domaine public / collection Rijksmuseum
Pendant des longues tournées dans les régions, où Louis va s’informer de l’état de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et du bien-être du peuple, il se fait accompagner par de nombreux experts néerlandais afin d’améliorer la communication et la rapidité d’action. De la même manière, il se dépêche sur les lieux lors d’inondations et d’incendies. Cette présence sur le terrain a un écho favorable parmi la population.
Mais tandis que les Néerlandais reconnaissent de plus en plus de qualités de «bon roi» à ce Français originaire de Corse, son frère l’Empereur lui fait de moins en moins confiance. La pomme de discorde concerne avant tout l’application peu sévère que fait Louis du blocus continental antibritannique: il ne veut pas ruiner encore d’avantage l’économie des Pays-Bas en interdisant tout commerce avec l’outre-mer. La guerre contre l’Angleterre étant fondamentale pour l’Empereur, celui-ci ne pardonne pas cette désobéissance, ni d’ailleurs le refus de Louis d’instaurer la conscription dans son royaume, qui aurait eu pour effet de procurer un maximum de soldats néerlandais à la Grande Armée.
Ne se rendant pas compte que les sanctions ne tarderont pas et toujours dans l’objectif d’inculquer une fierté nationale à ses sujets (et à lui-même?), Louis demande à Napoléon de l’argent pour doter la province de Drenthe –très peu développée– d’une capitale splendide. Il veut faire du village d’Assen un nouveau Versailles, les esquisses sont déjà prêtes. C’est la goutte qui fait déborder le vase. L’empereur ne répond plus du tout aux lettres de Louis et occupe manu militari le Brabant.
Sentant se lever un vent mauvais, le roi de Hollande, très affecté, abdique le 1er juillet 1810 et ce qui reste du royaume est annexé à l’Empire français jusqu’en 1813. Par la suite, Louis Bonaparte vit sous le nom de comte de Saint-Leu, d’abord en Autriche, puis en Italie où il décède en 1846. En 1852, son fils Charles-Louis Napoléon devient Empereur des Français sous le nom de Napoléon III.
 Jean-Hippolyte Flandrin, Portrait de S. M. l'Empereur, 1861. Il s'agit d'un portrait de Napoléon III, fils de Louis Bonaparte, aussi connu sous le nom de Charles-Louis Napoléon.
Jean-Hippolyte Flandrin, Portrait de S. M. l'Empereur, 1861. Il s'agit d'un portrait de Napoléon III, fils de Louis Bonaparte, aussi connu sous le nom de Charles-Louis Napoléon.© domaine public / collection musée de l'Histoire de France
L’héritage
Le système politique et administratif néerlandais actuel serait impensable sans la révolution batave, la République batave et le royaume de Hollande fondé par Louis Napoléon. Malgré le règne extrêmement court de ce dernier, il a réussi à remplacer les anciens antagonismes par un sentiment national et à rassembler ses sujets autour du trône. Selon l’historienne Annie Jourdan (3), un prince d’Orange n’aurait jamais pu devenir roi aux Pays-Bas sans Louis qui a réussi à imposer sa monarchie.
Avec le recul de plus de deux siècles, nous constatons que le transfert culturel qui a eu lieu à l’époque napoléonienne entre la France et les Pays-Bas a beaucoup contribué à la transformation des Pays-Bas en un État unitaire doté d’un parlement démocratiquement élu, d’une monarchie constitutionnelle, d’une constitution écrite, de droits individuels garantis, d’un système éducatif cohérent et de la liberté de religion. Il s’agit d’un héritage durable repris par les souverains de la maison d’Orange après la chute de Napoléon. (4)
Au cas où cette période partagée de l’histoire des Pays-Bas et de la France vous intéresserait et si jamais vous vous trouvez à Paris, je vous conseille de faire un détour par la banlieue nord afin de visiter Saint-Leu-la-Forêt et son église. Pour vous faire une idée du château des Bonaparte démoli en 1837, vous pourriez visiter le palais Het Loo à Apeldoorn aménagé par Louis dans le même style empire que son château de Saint-Leu.
Références:
- Lok, M. M. Windvanen, Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse restauratie (1813-1820), Bert Bakker, 2009.
- Stéphane Reecht. Louis Bonaparte, roi de Hollande dans le système napoléonien (1806-1810). Sciences de l’Homme et Société. École nationale des chartes, 2009.
- Sous la direction d’Annie Jourdan, Louis Bonaparte Roi de Hollande, Nouveau Monde éditions, 2010. Pour une interview avec l’historienne, écoutez l’épisode des Podacasts de l’Institut de France consacré à l’ouvrage.
- Guy Rooryck sur les plats pays sur Lotte Jensen, Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving, De Bezige Bij, 2020.
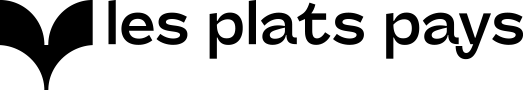






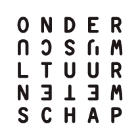
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.